 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Le Musée national d'art moderne propose une relecture de sa collection contemporaine en la réaccrochant en fonction du cinéma.
Le mouvement des images refuse pourtant "le cinéma spectacle" pour privilégier le seul cinéma d'avant-garde en faisant l'hypothèse que celui-ci permet de relire et de prolonger les oeuvres picturales.
En partant de thèmes associés au cinéma (défilement,
projection, récit et montage) l'exposition fait ainsi le pari
qu'elle pourra repenser l'image non plus à partir de la fixité
et de l'immobilité mais à partir du mouvement et de la reproductibilité.
Selon les commissaires : "Plutôt que comme un spectacle, le cinéma
apparaît aujourd'hui comme une manière de concevoir et de penser
les images, non plus à partir de la fixité et de l'immobilité
mais à partir du mouvement et de la reproductibilité."
Une exposition qui n'est pas destinée au cinéphile.
Ce propos généraliste ne pourra satisfaire le cinéphile. Ainsi les deux tableaux du MNAM qui font référence à Soudain l'été dernier de Joseph L. Mankiewicz (1959), Ten Lize d'Andy Warhol et Soudain l'été dernier de Martial Raysse sont-ils éloignés, l'un dans la section A, défilement, l'autre dans la section B, montage. Il va sans dire qu'aucun de ces deux tableaux n'a pour propos de travailler les concepts propres à Mankiewicz : la mémoire et la bifurcation.
La seule oeuvre qui m'a paru creuser les émotions du cinéma est Home stories (1991) de Matthias Müller qui sérialise quelques archétypes d'expressions de cinéma (surprise, regard, peur, nonchalance...) à partir d'extraits de films où apparaissent des stars féminines hollywwodiennes (Tippie Hedren , Grace Kelly, Laureen Bacall, Gene Thierney ou Bette Davis). Econome dans ses moyens, répétitive et surprenante cette oeuvre est tout à la fois splendide et fragile.
Il ne nous semble pas davantage que le MNAM cherche à travailler les rapports cinéma et peinture sous l'angle de la confrontation entre mouvements de peinture et mouvements de cinéma afin de voir ce que chaque art a pu produire de spécifique à partir des changements du sentiment décoratif et du sentiment imitatif.
Les concepts sont-ils transposables ?
L'exposition travaille sur le rapprochement des concepts. Ceux proposés par le MNAM sont peut être un peu trop plaqués sur la technique basique du cinéma et non sur les effets recherchés (profondeur de champ, cadrage...) mais ils invitent à la réflexion.
L'exposition rassemble en effet autour de films d'avant-garde, de films expérimentaux, de vidéos d'artistes et d'installations, plus de 200 œuvres empruntées aux "arts réputés statiques" - peinture, sculpture, photographie, mais aussi architecture et design - dans lequel figurent des oeuvres de Henri Matisse, Bruce Nauman, Barnett Newman, Man Ray, Frank Stella, Jeff Wall, Andy Warhol… Face à face, l'oeuvre pour Jean-Paul Sartre d'Hann Darboven répond aux huit études du Peintre et son modèle de Picasso. Les collages sonores et visuels d'Oracle de Rauschenberg rappellent les montages des Surréalistes. Plus loin, Men in the cities de Robert Longo placé à côté du Shoot de Chris Burden joue sur les codes et les genres du cinéma hollywoodien.
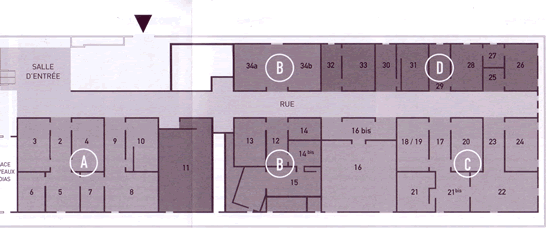 |
A : Défilement
Le dispositif cinématographique repose sur la division du ruban filmique en cadres, ou photogrammes, dont la projection intermittente à une cadence déterminée de 24 images par seconde produit une illusion de continuité.
Le film de Richard Serra, Hand Catching Lead, 1969, illustre ce dispositif. Suivant le mouvement vertical de la pellicule dans le projecteur, des feuilles de plomb tombent dans le champ de l'image. La main de Serra s'ouvre et se referme pour les attraper et lorsqu'elle y parvient, les relâche aussitôt, reproduisant ainsi le défilement intermittent du film. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Au fil de l'action, la main de Serra noircit au contact du plomb et dessine, comme une ombre, la silhouette approximative d'un chien cherchant à attraper au vol les objets qu'on lui jette ; il ramène ainsi le dispositif cinématographique à ses origines : la projection d'un spectacle d'ombres sur un mur.
En photographie, en sculpture ou en peinture, l'adoption de formats longitudinaux, l'usage de dispositifs séquentiels syncopés et discontinus, la division régulière du support ou la répétition des formes produisent des phénomènes de variation et de défilement qui en appellent à l'expérience cinématographique, indépendamment de tout appareillage technique.
Dans Ten Lizes, de Andy
Warhol, tableau peint en 1963, la célèbre actrice Liz Taylor
apparaît enveloppée dans l'aura que lui confèrent les
rôles qu'elle interprète à l'écran, tout en donnant
à voir la transformation de son corps en une image démultipliée
de copie en copie. Mais en dehors de son aspect figuratif, le tableau de Warhol
renvoie aussi sur un plan formel au cinéma : le découpage régulier
du support en unités distinctes et répétitives évoque
la division du ruban filmique.
La répétition inscrit l'oeuvre dans la temporalité. Les Date Paintings, inaugurés en 1966 par On Kawara portent la seule mention de leur date de réalisation ; la succession d'études exécutées par Picasso à quelques minutes d'intervalle pour Le Peintre et son modèle, 1970, tout comme les suites numériques agencées par Hanne Darboven dans Pour Jean-Paul Sartre, 1975, s'inscrivent dans la durée en utilisant les ressources de la sérialité.
Stan Brakhage, l'un des artistes les plus novateurs du cinéma expérimental d'après-guerre, visite la cathédrale de Chartres en 1994. L'observation minutieuse des vitraux lui sert alors de matériau pour Chartres Series. Le cinéaste transfigure le motif dans une utilisation virtuose de la caméra, et des aplats de couleur peinte directement sur la pellicule donnent matière à son film aux allures de "vitrail en mouvement". Les dessins préparatoires pour les vitraux de la chapelle de Vence auxquels Matisse travaille en 1948-49 évoquent quant à eux le dispositif cinématographique par la répétition des motifs floraux, les formats longitudinaux des papiers collés ou encore les inversions positif/négatif des fonds et des figures. Enfin, le vitrail est au dessin préparatoire ce que le film projeté est au film impressionné : un événement de lumière colorée.
B : Montage
"Le montage au cinéma n'est que l'application d'un principe plus général. Ce principe, envisagé dans toute sa complexité, excède largement le simple geste de coller des bouts de films ensemble". Ainsi, le cinéma n'est pour le cinéaste et théoricien Sergueï Eisenstein (1898-1948) que l'aboutissement d'un procédé d'assemblage qui traverse l'histoire des arts plastiques : le découpage de la surface picturale, les ruptures d'échelle entre les objets figurés, les jeux sur la transparence et l'opacité ou la superposition des plans, peuvent s'interpréter, à la lumière du dispositif filmique, comme des effets de montage.
Si l'image cinématographique a le pouvoir de contourner les objets, de les inscrire dans l'espace en démultipliant leur face visible, la peinture l'obtient par la décomposition prismatique du motif et la distorsion du plan. Dans son film Le Ballet mécanique, 1923-24, Fernand Léger invente des formes de collages et de montage ultrarapides, et applique au cinéma le principe cubiste de l'analyse des formes :
"On s'aperçoit que ces détails, ces fragments,
si on les isole, ont une vie totale et particulière. Il y a quelques
années, on ne considérait qu'une figure, qu'un corps, désormais
on s'intéresse et on examine curieusement l'oeil de cette figure. Des
jambes de femme, des pieds de femme, le bout du pied de la chaussure d'une
femme, son bras, son doigt, le bout de son doigt ; l'ongle, le reflet de l'ongle,
tout est "mis en valeur". Cela fonctionne comme une montre, comme
un revolver."
Les collages cubistes de Braque ou Picasso, surréalistes de Max Ernst
ou Man Ray, les assemblages pop de Martial Raysse ou James Rosenquist agencent
une multiplicité d'images ou de fragments d'images en une séquence
unique : ils rassemblent dans la simultanéité ce que l'expérience
ordinaire du cinéma déploie dans la succession. Les arts plastiques
produisent un équivalent statique de la dynamique et de l'enchaînement
des plans cinématographiques ; ainsi, Oracle,
1962-1965 de Robert Rauschenberg propose en contrepoint des collages visuels
de l'artiste un collage sonore, composé aléatoirement à
partir des ondes radio environnantes. Oracle
est un condensé de la vie urbaine : les fragments disparates qui le
constituent ont été prélevés dans la métropole
new-yorkaise avant d'être montés en un assemblage qui fait coexister
dans le même espace différents bâtiments, états
et situations de la ville. La collision des sources sonores qui proviennent
de chaque élément achève de figurer la cacophonie, le
brouillage, la simultanéité des bruits et la rumeur propres
au paysage urbain contemporain.
Le travail de cadrage est un procédé d'assemblage qui se déploie
sans fin et revient sur lui-même. Pour Deadpan, 1997, Steve McQueen
rejoue la célèbre cascade de Buster Keaton dans Steamboat
Bill Jr , 1928. Le mur d'une maison bascule sur l'artiste impassible,
dont le corps vient s'inscrire très précisément dans
l'ouverture d'une fenêtre découpée dans la façade.
Saisie sous différents points de vue, l'action se répète
plusieurs fois jusqu'à imposer au spectateur un rapport physique avec
les composantes de la perspective cinématographique : le plan et le
cadre. Le film est silencieux, le personnage ne bouge pas : c'est le décor
qui se déplace.
C : Projection
"Le film d'aujourd'hui, écrit László Moholy-Nagy en 1930, demeure encore sous la domination des conceptions dérivées du tableau traditionnel d'atelier, si bien que dans la pratique courante on n'aperçoit que fort vaguement le facteur principal du film qui est la lumière et non le pigment. "
En s'émancipant du modèle pictural, dans son film Jeu de lumière
noir-blanc-gris l'artiste enregistre les mouvements lents, accélérés,
ralentis, inversés du Modulateur espace-lumière, une structure
cinétique de métal et de verre qu'il achève en 1930 et
qu'il décrivait ainsi : "Mouvements, grilles étranges qui
se déplacent. Filtres "ivres", barreaux. Regards jetés
par de petites ouvertures ; diaphragmes automatiques. Éclair lumineux,
mouvant, aveuglant. Spirales tournoyantes, qui toujours reviennent. Toutes
les formes solides se dissolvent en lumière." Le film de Moholy-Nagy
propose ainsi une nouvelle définition de la plasticité et fait
de la manipulation et de la distribution de la lumière que permet le
cinéma un élément d'unification des arts.
L'oeuvre n'est plus conçue comme une forme statique, mais comme un champ traversé par un flux d'énergie. À l'objet clairement délimité dans l'espace se substitue un continuum en développement qui envahit l'espace environnant et se déploie dans le temps.
C'est à ce mode de représentation que Light Sentence,
1992, de Mona Hatoum en appelle : dans un espace vide, au milieu d'une construction
de casiers métalliques ajourés, une ampoule nue, actionnée
par un moteur, monte et descend, projetant l'ombre mouvante des casiers sur
les murs. Toutes les composantes du cinéma sont réunies, mais
agencées différemment ; et comme dans l'expérience du
cinéma, le visiteur perçoit le mouvement comme un principe de
séparation entre l'ombre et la clarté.
Au début des années 1930, Brancusi acquiert une caméra et réalise un premier film autour du grand Poisson. Vers 1936, il relie le plateau circulaire de Léda, 1926, à un moteur électrique. Le geste de Brancusi mettant en mouvement ses sculptures trouve un prolongement dans l'enregistrement d'images cinématographiques : la caméra sera l'outil irremplaçable permettant de saisir les reflets et les ombres que la sculpture reçoit et projette dans un tournoiement de lumière, qui transperce et altère la masse compacte et solide de la forme.
Les Pierres de lait que Wolfgang Laib réalise à partir de 1975 sont des oeuvres contemplatives. Dans un réceptacle de marbre entouré d'un fin rebord, on verse du lait chaque matin : le visiteur est invité à méditer sur les effets d'opacité et de réfraction de la surface blanche qui s'étend sur le sol comme un écran horizontal sur lequel, au fil de la journée, une mince pellicule, littéralement un film, vient se déposer de manière presque imperceptible. Ces Pierres de lait ouvrent sur le même type d'expérience que le Zen for Film, 1964, de Nam June Paik, qui donne à voir une projection d'amorce transparente sur un mur où le spectateur vient contempler les poussières s'accumulant et les griffures qui strient la pellicule telles des rayures de sable à la surface d'un jardin zen, un film-jardin dressé à la verticale.
D: Récit
Après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma de fiction ; essentiellement le cinéma de genre hollywoodien ; fait massivement son entrée dans le travail des plasticiens en même temps que la culture populaire obtient définitivement droit de cité sur la scène artistique.
Dans les années 1960, les artistes trouvent dans la science-fiction
ou le cinéma fantastique, plus que dans le cinéma d'auteur,
un nouveau matériau émotif et perceptif. Le 19 novembre 1971
à 19 h 45, Chris Burden se fait tirer une balle dans le bras. La performance
est aussi légendaire que le film qui en témoigne est anti spectaculaire.
Il n'y a que huit secondes d'image. La caméra super-8 émet un
bruit caractéristique au moment de son enclenchement, l'image apparaît,
le coup de feu part, l'artiste s'avance en se tenant le bras. L'écran
redevient noir, une cartouche vide fait du bruit en tombant sur le sol.
"Je pense que le public américain a toujours été fasciné par les photographies de vrais morts ou de gens en train de mourir, explique Robert Longo ; lorsque les films et la télévision ont fait leur apparition, ils ont donné une version stylisée de ces images." Pour réaliser la série de dessins Men in the Cities, 1980-1999, en référence au cinéma d'action contemporain, Longo dirige ses modèles comme un réalisateur ses acteurs : il les emmène sur des toits d'immeubles, leur envoie des projectiles et les photographie en perte d'équilibre. À partir des photos projetées en grand format, il élabore ses figures par un travail de montage et de détourage. Dans l'écart entre les corps suspendus de Robert Longo et la rugosité des images de Burden, entre figure idéale et réalité documentaire, se déploie tout l'arsenal stylistique du "cinéma de genre".
Dans les années 1920, Francis Picabia célèbre dans les récits du cinéma d'action un dispositif anti-esthétique susceptible d'opposer à la culture visuelle "aristocratique" un système de contre-valeurs. "Ce que j'aime, écrit-il, c'est la course à travers le désert, les savanes, les chevaux en nage. Le cow-boy qui entre par les fenêtres du bar-saloon, l'éclatement des vitres, le verre de whisky vidé à angle droit dans un gosier rude et les deux brownings braqués sur le traître."
Une scène de meurtre, une piscine couleur azur sous le soleil de la
Californie, une Cadillac dont le klaxon joue la musique du Parrain, des abstractions
cinématographiques, La Moindre Résistance, 1981, de Peter
Fischli et David Weiss, met en scène les deux artistes sous les traits
d'un rat et d'un ours géants qui semblent radicaliser, dans une fable
policière aux résonances métaphysiques, le programme
de Picabia.
En 1936, Eli Lotar prend des photos sur le plateau de tournage d'Une partie de campagne de Renoir. Il multiplie les points de vue, double ceux de la caméra, adopte des angles inaperçus à l'écran : ces fragments de récit sont l'amorce d'une narration plus vaste, celle du film en train de se faire.
En revanche, les Two Impossible Films, 1995-97, de Mark Lewis prennent pour argument deux projets qui n'ont jamais vu le jour : une adaptation par Eisenstein du Capital de Marx et un projet de film, une histoire d'amour, que Samuel Goldwyn espérait produire avec le concours improbable de Freud. Lewis réalise en cinémascope et dolby stereo les génériques de début et de fin de ces films, déconstruction ironique du récit du cinéma hollywoodien.
Source : Musée d'Art Moderne


